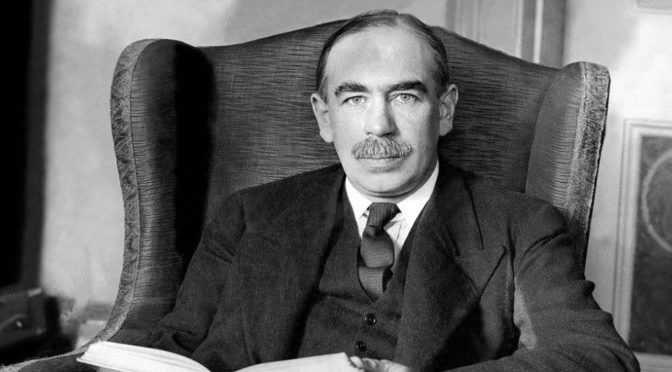1. Les notions
Les soldes budgétaires, les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques
-
Le solde public : c’est la différence entre les ressources publiques (impôts, cotisations, autres recettes) et les dépenses publiques (personnel, fonctionnement, intervention, etc.).
- On l’exprime en valeur absolue ou plus souvent en pourcentage du PIB.
- En déficit depuis 1975 en France (-2,9 % en 2017 ; -2,6 % en 2018 (p)).
- Le déficit est un flux qui alimente le stock de dette (96,8 % en 2017 et 2018).
- Prévisions de déficit construites selon des hypothèses d’inflation et d’élasticités en recettes (1,2 en 2016 : +1,9 % vs. +1,6 % Y en valeur) et tendanciel de dépenses (env. +20 Md€ par an). Depuis la création du HCFiP, moins d’écart entre prévision et exécution (crédibilité).
-
Le solde structurel : c’est la différence entre le solde budgétaire et le solde conjoncturel (construit par rapport à Y*).
- Le solde structurel permet de neutraliser les effets du cycle économique.
- Référence des organisations internationales, permet de mesurer l’effort structurel.
- -2,2 % en 2017 ; -2,1 % en 2018 (PLF 2018).
-
· Les autres soldes budgétaires
- Le solde primaire : solde budgétaire neutralisé des intérêts de la dette (-0,8 % en 2018). Mesure la soutenabilité budgétaire.
- Le solde stabilisant : solde budgétaire à partir duquel le ratio dette/PIB se stabilise. Solde stabilisant = (taux d’intérêts réels – taux de croissance) * ratio dette/PIB. Objectif à atteindre pour stabiliser la dynamique de la dette. Egal à 3 % si la croissance du PIB en valeur est de +5 %, les taux d’intérêts réels de 0 % et la dette de 60 %.
- Mais l’interprétation de ces soldes doit être relativisée car leur calcul dépend de la conjoncture (croissance et taux d’intérêt).

Les justifications de l’endettement et le multiplicateur keynésien
-
Les justifications théoriques de l’endettement public (ensemble des emprunts émis ou garantis par les administrations publiques et dont l’encours résulte de l’accumulation des déficits publics) :
- Investissement public (vs. dépenses de fonctionnement) dans la mesure où les générations futures en bénéficient.
- Arrow & Lind (1970) : l’Etat s’endette à meilleur coût (diversifie le risque et le dilue pour les contribuables). Le marché de la dette publique est liquide (transactions rapides et peu coûteuses) et profond (peut réaliser des transactions en grande quantité sans variation majeure des cours). Les obligations souveraines représentent une réserve de valeur (support de transactions), mais aussi un collatéral (garantie) apporté aux banques centrales et un placement pour les compagnies d’assurance et fonds de pension). Notamment vrai pour le Dollar : monnaie d’échange internationale => forte liquidité => endettement à bas coût.
- Tax smoothing : le recours à l’endettement public permet de lisser le niveau des PO sur le cycle et de minimiser les distorsions fiscales (Barro, 1979).
- Stabilisateurs automatiques : l’endettement permet de lisser les variations du cycle (Nelson & Plosser, 1982 : ex. tax cut Kennedy en 1962 IR/IS 2,3 pts PIB : stimulus pour réduire le chômage : -1,5 pt).
- Se prémunir contre des risques durables de dysfonctionnement des marchés : not. effets d’hystérèse sur le marché du travail (Blanchard & Summers, 1986).
- Aussi dans le secteur privé : accompagner les phases de croissance de l’entreprise en finançant son fonds de roulement ou le décalage entre investissement et cash-flow généré. Alternatives : autofinancement ou augmentation du capital.
-
Le multiplicateur keynésien (relation entre la variation des dépenses publiques et la variation du revenu qu’elle génère)
- Kahn, 1931 puis Keynes, 1936 : le déficit public génère une production supplémentaire, qui est proportionnel selon un facteur k (le multiplicateur).
- Mesure discutée mais certain que 1/ plus élevée en bas de cycle (Robert Lucas à un journaliste du Times le 28 octobre 2008 : « Dans les tranchées, tout le monde est keynésien »), 2/ différent en dépenses et en PO (selon les pays : ex. France plus élevé en dépenses ; USA plus élevé en PO), 3/ dépend de la nature des hausses de dépenses ou des baisses de PO, 4/ dépend enfin du niveau d’endettement public et des marges de manœuvre budgétaires (cf. infra).
-
Quelques études expérimentales :
- Baisse du taux moyen de taxation de -1 % => hausse de l’offre de travail de +0,5 % (Chetty, 2011 : ex. réformes au DK).
- A l’inverse, hausse fiscalité +1 % PIB => baisse de 3 % du PIB au cours des trois années qui suivent (Romer, 2010 : ex. USA depuis SGM).
- Impact hausse dépenses plus élevé dans régions où revenu/hab plus faible : k = 1,6 en moyenne, 3 au max (Serrato, 2016).
- Mauvaise allocation des dépenses possible : ex. FEDER effet positif sur le revenu dans seulement 30 % des cas : régions où la qualité des services publics est déjà intermédiaire et où faible biais politique dabs l’allocation des ressources publiques (Becker, 2013).
- Théorème d’Haavelmo (1989) : une relance budgétaire est aussi possible sans emprunt, par la hausse des PO, mais multiplicateur plus faible (proche de 1).

Les critiques de l’endettement
-
Les incidences macro-économiques de l’endettement public
- L’équivalence néo-ricardienne (Barro, 1974) : tout déficit budgétaire est analysé par les agents économiques comme une hausse d’impôt future (épargnent le surcroît de revenus plutôt que de le consommer). Se vérifie empiriquement à partir de 90 % de PIB d’endettement : perte de 1 à 3 points de Y* (Reinhart & Rogoff, 2009). Par ailleurs, effet d’éviction au détriment de l’investissement privé : à prévenir par une politique monétaire accommodante (policy-mix : stratégies de combinaison de la politique budgétaire et de la politique monétaire).
- La charge de la dette : handicape la conduite de la politique monétaire. Ex 41,5 Md€ pour le budget de l’Etat en France (PLF 2018), 2è budget derrière l’enseignement scolaire.
- Existence d’une prime de risque : hausse des taux d’intérêts pour les pays déjà endettés (effet « boule de neige »), notamment quand détention de la dette par des non-résidents (2/3 en FR vs. 7 % au Japon). OCDE : au-delà de 75 % de dette/PIB, +1 pt de dette/PIB => +10 pts de base de taux d’intérêts.
- Par ailleurs, l’ouverture économique a aussi réduit le multiplicateur budgétaire : effet d’éviction au profit de consommation importée (creuse le déficit commercial sans stimuler la production nationale). Ex. relance de 1 % PIB en 1981 => inflation 13,4 %, déficit -2 pt, balance commerciale -10 Md€ (en € courants).

-
La dynamique de l’endettement public
- Loi de Wagner (1872) : progrès économique => hausse du ratio dépenses publiques/PIB. Dépenses d’investissement public pour soutenir le développement éco (ex. infrastructures) + production de services publics pour répondre aux besoins (éducation, santé, logement : biens dont la consommation augmente plus vite que le PIB).
- Notion de soutenabilité : une dette publique est jugée soutenable si, compte tenu des prévisions de dépenses et de recettes publiques, l’Etat ne risque pas de se trouver face à une crise de solvabilité ou à une obligation d’ajustement irréaliste des finances publiques.
- Solvabilité : capacité à rembourser le capital de ses dettes et à payer les intérêts qu’elle implique. Un Etat est solvable quand sa dette publique reste soutenable. Dépend du stock de dette, du déficit, de la croissance potentielle et des taux d’intérêts. Dt = Dt-1 x (r – Y*)
- Différence avec une crise de liquidités : cas dans lequel un Etat n’est plus capable de s’endetter pour financer son déficit car les créanciers refusent de lui prêter (rôle des agences de notations). Ex. de la Grèce ou de l’Argentine : n’ont plus accès aux marchés, nécessite aide internationale (FMI) et/ou défaut/austérité.
Comment réduire sa dette ?
-
Trois voies de réduction de l’endettement public :
- Par la croissance : taux de croissance en volume (y c inflation) supérieur aux taux d’intérêts (ex. Trente Glorieuses : réduction lente ex. USA 116 % PIB en 1945 => 22 % PIB en 1974)
-
Par le solde budgétaire : dégager un excédent primaire (ex. Allemagne +1,2 %)
- Par la hausse des PO ou la réduction des dépenses ? Dépend du multiplicateur fiscal : selon DG Trésor (2012), +1pt PO = -0,4 Y vs. -1pt DP = -0,8 Y
- Alesina & Ardagna (2009) : pour les économies surendettées, la réduction du déficit restaure la confiance et augmente l’investissement privé. La consolidation budgétaire est donc expansionniste à moyen terme quand le multiplicateur budgétaire est bas (inférieur ou égal à 1 : ~0,8 en UE). Les agents anticipent des baisses d’impôts futures (Friedman, 1957 : théorie du revenu permanent)
- Par la répression financière (Reinhart & Sbrancia, 2011) : orienter l’épargne privée vers le refinancement de la dette publique pour réduire les taux d’intérêts en-dessous de la croissance (ex. accord FED-Roosevelt en 1942 maintien taux bas). Mais mauvaise allocation du capital (McKinnon & Shaw, 1973) et perte de croissance potentielle.
- Dans tous les cas, la stratégie doit dépendre de la situation du pays : des multiplicateurs budgétaire et fiscal ; de l’existence d’une crise de liquidités ou de solvabilité. Si crise de liquidités, aide internationale. Si crise de solvabilité, inutile de prêter davantage, il faut restructurer la dette (rééchelonner et/ou réduire) + consolider le déficit. Rogoff (2009) : 300 défauts souverains depuis le XIXème siècle (ex. France et USA après la PGM). Questions : aléa moral + burden sharing entre les créanciers (effets redistributifs). Effet positif possible sur la Y* si le défaut permet de financer de nouveaux investissements publics utiles.
2. Les outils
L’ajustement par la dépense : le cas des pays anglo-saxons et de l’Allemagne
-
Une réduction des dépenses publiques…
- Déclenchement lorsque la dette publique approche 100 % PIB du fait de déficits cumulés (-9,2% déficit en 1994 au Canada puis excédent +0,2 % en 1997 ; Suède 12 % déficit en 1993 et 80 % dette en 1995 ; Allemagne déficit -4,1 % en 2010 vs. +0,8 % en 2016)
- Réduction des dépenses de masse salariale (gel des salaires et réduction d’effectifs dans la fonction publique), de fonctionnement (Digital By Default au RU) et d’intervention (redéfinition des missions du secteur public, plafonnement des prestations sociales au RU et réduction en Allemagne avec Hartz IV) => forte sélectivité des baisses de dépenses (ex. -2,4 % dépenses en volume au RU entre 2009 et 2012 cf. France Stratégie, 2015)
- Des règles de gouvernance : budgets triennaux en Suède avec plafonnement des dotations ministérielles, règle d’or (pour les budgets locaux en Suède, Schuldenbremse à 0,35 % de déficit structurel pour le budget fédéral en Allemagne), hypothèses de croissance prudentes, dépenses calées sur les prévisions de recettes et comités budgétaires indépendants (ex. Congressional Budget Office aux USA)
-
…Rendue possible par un contexte macro-économique favorable
- Une croissance mondiale autour de 4-5 % dans la décennie 1990s
- Un contexte d’inflation et de dévaluation monétaire (dépréciation de 25 % du CAD // à l’USD : 1 USD = 0,63 CAD en 2002 ; Vidal, 2010 : dévaluation de la couronne suédoise a accru les exportations)
- Un risque de handicaper la croissance potentielle : faiblesse des investissements publics en Allemagne (Duval, 2013 : 1,5 % du PIB, soit inférieur à la moyenne OCDE), prise en charge insuffisante de la petite enfance (OCDE, 2014) et démographie négative (25 M de retraités en 2030)

L’ajustement par les recettes : le cas de l’Irlande et de la France
-
En Irlande : transmission de la crise financière à la crise des finances publiques
- « Tigre celtique » : une croissance de 5 à 10 % a fait diminuer de moitié le ratio dette/PIB durant la décennie 1990
- Mais bulle immobilière et recapitalisation des banques => 32 % déficit en 2010
- Dette publique de 25 % PIB en 2007 à 124 % en 2013 (*5)
-
En France : une préférence collective pour la dépense publique
- Un écart de 6,5 pts de PIB en DP par rapport à la moyenne OCDE, en particulier sur les dépenses sociales (système de retraites = 3/4 de l’écart) et rigidité des dépenses dans leur composition (France Stratégie, 2016)
- Peu d’efforts structurels sur la dépense publique (11 Md€ d’économies avec la RGPP ; 29 Md€ avec le plan d’économies 2015-2017 mais toujours calculées par rapport au tendanciel : les dépenses ont continué à évoluer en volume) => dette proche de 100 % de PIB
- Historiquement, une politique budgétaire peu coordonnée avec le cycle économique : depuis 1980, seulement 6 % cas consolidation en phase haute et 11 % relance en récession.
-
Un ajustement brutal après 2008
- En France entre 2009 et 2015, +3,6 pt de PIB en PO (entreprises et ménages) alors que les DP continuaient d’augmenter de +0,7 pt => pèse sur les facteurs de production et réduit croissance effective (inférieure à 1 % entre 2012 et 2015)
- En Irlande, consolidation budgétaire aux 2/3 par les PO, soit +12 % PIB (introduction d’une taxe foncière et d’une taxe sur l’eau par ex. : pression fiscale +1 000 € / foyer). Aussi effort en dépenses (réduction de la masse salariale de 17 %) et aide internationale pendant 3 ans (FESF et FMI = 67 Md€)


3. Les défis
Les conditions pour réussir un désendettement
-
Les conditions historiques pour la réussite des stratégies de désendettement
- Etude du FMI (2012), “The Good, the Bad, and the Ugly: 100 Years of Dealing with Public Debt Overhangs” : Entre 1875 et 1997, plus de la moitié des pays industrialisés ont dépassé le ratio de 100 % dette/PIB
- Un environnement monétaire accommodant est une condition sine qua non. Ex. USA après 1945 (PM non conventionnelle : achat de titres publics et taux très bas => l’inflation résorbe l’endettement)
-
Le lien entre politiques de dévaluation interne et dette en temps de crise
- Paradoxe de Fisher (1933) : en période de crise, le désendettement public entraine chômage et croissance faible. Boucle dépressive : demande privée déprimée => déflation => récession => augmente la valeur réelle de la dette.
- De Grauwe (2013) : Depuis 2008, pays où la consolidation a été la plus forte en UE ont connu la plus forte baisse de PIB et d’accroissement de la dette => inefficacité des consolidations si récessives (càd si réalisées par la hausse des PO ou la baisse de dépenses productives).
- Par contraste, politiques de relance budgétaire efficaces lorsque le multiplicateur keynésien est élevé et que l’équivalence néo-ricardienne ne joue pas ex. New Deal (impulsion de +1,5 % PIB en 1934). DeLong & Summers, 2012 : multiplicateur budgétaire supérieur à 1 en moyenne OCDE (1,2 en France pour l’OFCE) et taux d’intérêt faibles = opportunité pour augmenter l’investissement public.
L’encadrement européen et international
-
Aujourd’hui, la politique budgétaire au sein de l’UEM est soumise à des règles…
- Kydland & Prescott (1977) : incohérente temporelle des politiques budgétaires
- Pacte de stabilité (1997), TSCG (2012) : 3 % déficit, dont 0,5 % structurel, 60 % dette et définition OMT par pays
- Déclinaisons nationales : loi organique du 17/12/2012 en France
- Pb de crédibilité : des règles jamais appliquées ? (Conseil européen de 2005)
-
…Mais elle est également contrainte par la compétition fiscale
- Réduction généralisée de l’impôt sur les sociétés (CEPII, « Impôt sur les sociétés : tous à 0 % ? », 2005). Ajd 25 % en moyenne UE contre 33 % en 1999 : réduction à 20 % au Royaume-Uni, 12,5 % en Irlande, 29,6 % en Allemagne mais stabilité norme fiscale, perspective 25 % en France en 2022 et réduction de 35 % à 15 % aux USA avec Trump. Facteur d’attractivité du territoire (mais pas le seul : infrastructures, formation, etc).
-
Politiques de dévaluation interne, ex. Espagne depuis 2011 :
- Amélioration de la compétitivité-prix et des exportations (excédent commercial de +4 % PIB en 2015), hausse de la profitabilité des entreprises (+3 pts), baisse des salaires réels (-10 %)
- Croissance de 3,2 % en 2016, chômage à 17 % vs. 26 % en 2013, mais déficit public 3,3 % en 2017 (tjs jugé excessif par la CE) et dette publique ~ 100% PIB
Trois orientations pour la politique budgétaire en France pour 2017-2022
- Opérer une réduction sélective des dépenses publiques : sphère sociale (objectif -40 Md€ d’ici 2022, impossible sans un effort sur les retraites et l’assurance-maladie : Ondam à 2,3 % sur le quinquennat vs. 1,75 % en 2016), collectivités territoriales (effort de 13 Md€ sur les dépenses de fonctionnement plutôt que sur les dépenses d’investissement, réduction de la masse salariale) et fonction publique (-100K fonctionnaires sur le quinquennat = -2,8 Md€ en cumulés ; aussi gel du point d’indice : +1 % masse salariale des trois FP = +900 M€ et rétablissement du jour de carence : 170 M€ d’économies par an).
- Recours au levier fiscal marginal (notamment sur les 450 niches, soit 82 Md€, ex. TVA réduite restauration = 2,6 Md€ de moindres recettes pour un secteur non exposé à la concurrence internationale). Baisses de fiscalité sur les ménages (TH, cotisations salariales) mais hausses de fiscalité comportementale (tabac, diesel). Simplifications pour les entreprises : transformation du CICE en allègements généraux de cotisations employeurs en 2019.
- Recycler une partie des économies pour stimuler la croissance potentielle dans un contexte de taux d’intérêt faibles : financement du plan de formation pour les DELD et jeunes décrocheurs, investissements dans la transition écologique (ADEME, Anah, etc.), réduction de la fiscalité sur le capital (IS à 25 %, flat tax à 30 %).