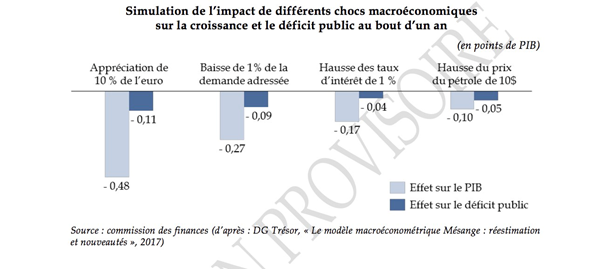1. Quelques définitions et chiffres-clés
Qu’est-ce que le déficit public ?
Lorsque les ressources publiques (impôts, cotisations, autres recettes) sont inférieures aux dépenses publiques (personnel, fonctionnement, intervention, etc.).
Ex. France : depuis 1974. Flux qui alimente le stock de dette.
Périmètre : public = ensemble de la sphère publique (Etat et opérateurs, APUL, ASSO).
Important : permet des comparaisons internationales.
Quand trouve-t-on généralement des déficits publics ?
En période de crise, stabilisateurs automatiques pour lisser le cycle (ex. Tax Cut Kennedy en 1962 : baisse de l’IR et de l’IS de 2,3 pts de PIB : baisse du chômage de 1,5 pt). Aussi se prémunir contre dysfonctionnements durables des marchés (ex. effet d’hystérèse sur le marché du travail : Blanchard et Summers, 1986).
Dans les pays en voie de développement, car investissement public (vs. dépenses de fonctionnement) dans la mesure où les générations futures en bénéficient et l’Etat s’endette en principe à meilleur coût.
En réalité, tous pays ont connu déficit public (financer une guerre, financer des promesses électorales, existence de gaspillages, baisse des recettes fiscales du fait de l’évasion etc.).
Comment prévoit-on le déficit public ?
3,2 % prévu en PLF 2019.
Prévisions de déficit construites selon des hypothèses de croissance, d’inflation mais aussi d’élasticités en recettes (estimée à 1,2 en 2016, càd que lorsque la croissance est de 1,6 % en valeur, les recettes fiscales croissent de +1,9 %) et de tendanciel en dépenses (env. +20 Md€ par an).
Depuis la création du Haut conseil des finances publiques en 2012 (obligation du TSCG : crédibilité de la signature souveraine), mais n’empêche pas un écart entre les prévisions et l’exécution du déficit public (du fait des variations de la conjoncture). Bonne pratique : budgéter « prudemment » (3 % des crédits mis en réserve en cas de mauvaise surprise, règle tacite de désendettement en cas de bonne surprise cf. polémique sur la « cagnotte »).
Question mesure de la dette : engagements hors bilan type retraites (x1,8 dette publique comptabilisée).
Qu’est-ce que le déficit structurel ?
C’est la différence entre le solde budgétaire et le solde conjoncturel (construit par rapport à l’estimation de croissance potentielle).
- Il permet de neutraliser les effets du cycle économique.
- Référence des organisations internationales (CE), permet de mesurer l’effort structurel (ex. en 2018 : réduction de 0,1 point du déficit structurel vs. 0,3 de baisse du déficit : les 2/3 sont liés à la conjoncture càd une croissance de 1,6 % selon l’INSEE).
2. Les dilemmes de la politique économique
Comment assurer une relance efficace ?
L’indicateur : le multiplicateur keynésien (relation entre la variation des dépenses publiques et la variation du revenu qu’elle génère)
Kahn, 1931 puis Keynes, 1936 : le déficit public génère une production supplémentaire, qui est proportionnelle selon un facteur k (le multiplicateur).
Mesure discutée mais certain que :
1/ plus élevée en bas de cycle (Robert Lucas à un journaliste du Times le 28 octobre 2008 : « Dans les tranchées, tout le monde est keynésien »),
2/ différent en dépenses et en PO (selon les pays : ex. France 2x plus élevé en dépenses selon DG Trésor (2012), une baisse de 1 PP des PO (respectivement une hausse de 1 PP des dépenses) induirait une hausse de 0,4 PP de la croissance potentielle (respectivement de 0,8 PP) ; USA plus élevé en PO),
3/ dépend de la nature des hausses de dépenses ou des baisses de PO,
4/ dépend enfin du niveau d’endettement public et des marges de manœuvre budgétaires (cf. infra).
Que disent les études expérimentales ?
1/ De manière générale, la quantité de travail effectuée est sensible à une modification du barème de l’impôt sur le revenu [Bianchi et alii, 2001 : la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en Islande en 1988 avec absence d’imposition des revenus durant l’année de transition dite « année blanche » a accru de 6,7 % le nombre de semaines travaillées en 1987). Baisse du taux moyen de taxation de -1 % => hausse de l’offre de travail de +0,5 % (Chetty, 2011 : ex. réformes de la fiscalité au Danemark).
2/ A l’inverse, hausse fiscalité +1 % PIB => baisse de 3 % du PIB au cours des trois années qui suivent, puis les effets s’estompent (Romer, 2010 : ex. réformes fiscales aux Etats-Unis depuis 1945 ; baisse de 2,5 % au Royaume-Uni selon Cloyne, 2013).
3/ Impact hausse dépenses plus élevé dans les comtés où le revenu par habitant est le plus faible : k = 1,6 en moyenne, 3 au max (Serrato, 2016). Idem pour les dépenses militaires k = 1,5 en moyenne et entre 0,5 et 3 selon les régions (Nakamura, 2014).
4/ Mauvaise allocation des dépenses possible : ex. FEDER effet positif sur le revenu dans seulement 30 % des cas : régions où la qualité des services publics est déjà intermédiaire (car cofinancement) et où faible biais politique dans l’allocation des ressources publiques (Becker, 2013).
=> Pour une politique de relance efficace, le tissu économique doit être réactif (fonctionnement marchés financiers, travail et produits) + bonne gestion publique et réactions adaptées des autorités monétaires (pas de remontée brutale des taux) pour éviter qu’un surcroît de dépenses publiques ne déprime l’activité. Ex du Recovery Act 787 Md€ (5,5 % du PIB) réussi sous Obama (mais pas encore d’étude ex-post sur le multiplicateur budgétaire).
Faut-il baisser les impôts ou augmenter les dépenses ?
Pas de règle générale :
1/ Pour les dépenses, dépend de la propension marginale à consommer des ménages (pour 1€ de prestation en plus, combien de consommation/épargne ?), de la part de la consommation importée (pour 1€ de consommation supplémentaire, combien est importée ?). Ex. relance de 1 % du PIB en 1981 => balance commerciale -10 Md€ entre 1980 et 1982 (en € courants).
2/ Pour les prélèvements obligatoires, dépend de l’incidence fiscale (sur qui est répercutée la baisse d’impôts ?). Maximiser l’effet sur l’activité en ciblant le revenu disponible d’agents ayant une forte propension marginale à consommer. Ex. Zidar, 2018 sur l’IR aux USA : multiplicateur de 0 pour le top 10 % (paient déjà relativement peu d’impôts) vs. multiplicateur de 7 pour les 90 % autres.
Traditionnellement, baisse de l’IR ou de l’IS (ex. Kennedy). En réalité, TVA plus efficace : -1 point de PIB = +3,7 % de PIB au bout d’un an (Riera-Crichton, 2016 dans 14 pays OCDE) même si une partie absorbée par les marges des producteurs (ex. TVA restauration : entre 55 et 80 % de la baisse captée par les restaurateurs, Laffeter et Sillard, 2004). Idem taxes foncière ou d’habitation car affecte des agents ayant une propension marginale à consommer relativement forte (Geerolf et Grjebine, 2018).
=> Mieux vaut baisser les impôts sur les revenus ou augmenter les prestations sociales ciblées dans les économies où la consommation est prépondérante (ex. France) vs. baisser les impôts sur la production là où l’investissement est prépondérant.
Comment savoir quand il faut relancer ?
Différence entre relance / consolidation (bas de cycle vs. haut de cycle : problème d’identifier où l’on se situe dans le cycle : entre 1980 et 2015 selon France Stratégie, 46 % du temps pro-cyclique – relance en haut de cycle ex. 2007 ou consolidation en bas de cycle ex. 2012 – et 36 % acyclique + biais intertemporel des politiques économiques) et relance / structurel (croissance effective vs. croissance potentielle).
Egalement, savoir réagir aux événements ex. en ce moment : ralentissement de la conjoncture en zone euro + mouvement social (0,1 point de PIB en moins) justifie mesures de pouvoir d’achat pour soutenir la consommation en France (10 Md€ en 2019).
La relance est-elle toujours efficace ?
L’équivalence néo-ricardienne (Barro, 1974) : tout déficit budgétaire est analysé par les agents économiques comme une hausse d’impôt future (ils épargnent donc le surcroît de revenus induit par l’impulsion budgétaire plutôt que de le consommer).
- Se vérifie empiriquement à partir de 90 % de PIB d’endettement : perte de 1 à 3 points de croissance potentielle (Reinhart & Rogoff, 2009).
- Par ailleurs, effet d’éviction au détriment de l’investissement privé (plus de demande de monnaie => hausse des prix à savoir les taux d’intérêt) : à prévenir par une politique monétaire accommodante (policy-mix : stratégies de combinaison de la politique budgétaire et de la politique monétaire).
Par ailleurs, l’ouverture économique a aussi réduit le multiplicateur budgétaire : effet d’éviction au profit de consommation importée (creuse le déficit commercial sans stimuler la production nationale).
=> Il est plus efficace de relancer quand la politique budgétaire est déjà crédible (dette soutenable) et quand les taux d’intérêt sont bas (moins d’effet d’éviction)
Que se passe-t-il si le déficit public explose ?
1/ Il est normal que les dépenses publiques augmentent. Loi de Wagner (1872) : « plus la société se civilise, plus l’Etat devient dispendieux ». Idée que le progrès économique induit une hausse du ratio dépenses publiques/PIB (vérifiée empiriquement, ex. Dudley et Montmarquette, 1992). Dépenses d’investissement public pour soutenir le développement éco (ex. infrastructures) + production de services publics pour répondre aux besoins sociaux (éducation, santé, logement : biens dont la consommation augmente plus vite que le PIB).
2/ Mais le financement de la dette constitue une charge d’intérêts pour les finances publiques : handicape la conduite de la politique budgétaire. Ex. 42 Md€ pour le budget de l’Etat en France (PLF 2019), 2ème poste budgétaire derrière l’enseignement scolaire.
3/ Par ailleurs, il peut exister une prime de risque : hausse des taux d’intérêts pour les pays déjà endettés (effet « boule de neige »), notamment quand détention de la dette par des non-résidents (2/3 en FR vs. 7 % au Japon). Selon l’OCDE, au-delà de 75 % de dette/PIB, +1 pt de dette/PIB => +10 pts de base de taux d’intérêts (+0,1 PP). Selon la Cour des comptes, +1 PP de taux d’intérêt = +15 Md€/an intérêts à horizon n+10.
Quand faut-il réduire son déficit public ?
Traditionnellement, dégager un excédent primaire (solde public positif avant charge de la dette) pour réduire sa dette lorsque sa soutenabilité est menacée et que l’économie est en haut de cycle (ex. Allemagne +1,2 % du PIB en 2017)/
Mais depuis Alesina & Ardagna (2009), idée que pour les économies surendettées, la réduction du déficit restaure la confiance et augmente l’investissement privé. La consolidation budgétaire serait donc expansionniste à moyen terme quand le multiplicateur budgétaire est bas (inférieur ou égal à 1 : ~0,8 en UE). Les agents anticiperaient en effet des baisses d’impôts futures selon la théorie du « revenu permanent » (Friedman, 1957). Mais pas vérifié empiriquement (plutôt boucle dépressive, cf. infra).
Ex. des pays anglo-saxons qui ont ajusté leur déficit public par la dépense :
– Déclenchement lorsque la dette publique approche 100 % PIB du fait de déficits cumulés (déficit équivalent à 9,2 % du PIB en 1994 au Canada puis excédent de 0,2 % en 1997 ; Suède 12 % déficit en 1993 et 80 % dette en 1995 ; Allemagne déficit 4,1 % en 2010 vs. excédent de 1,2 % en 2017)
– Réduction des dépenses de masse salariale (gel des salaires et réduction d’effectifs dans la fonction publique), de fonctionnement (doctrine Digital By Default pour dématérialiser les services publics au Royaume-Uni) et d’intervention (redéfinition des missions du secteur public, plafonnement des prestations sociales au Royaume-Uni et réduction des indemnités chômage en Allemagne avec Hartz IV) => forte sélectivité des baisses de dépenses (baisse de 2,4 % des dépenses en volume au Royaume-Uni entre 2009 et 2012, avec un indice de sélectivité 3x plus élevé qu’en France selon France Stratégie, 2015)
– Mais rendue possible par un contexte macro-économique favorable : croissance mondiale autour de 4-5 % dans la décennie 1990, contexte d’inflation et de dévaluation monétaire (dépréciation de 25 % du dollar canadien par rapport au dollar américain : 1 USD = 0,63 CAD en 2002 ; Vidal, 2010 : la dévaluation de la couronne suédoise a accru les exportations, ce qui a permis de soutenir la croissance malgré la réduction des dépenses publiques) et risque d’handicaper la croissance potentielle : faiblesse des investissements publics en Allemagne (Duval, 2013 : 1,5 % du PIB, soit un niveau inférieur à la moyenne OCDE à 2,7 % : 40 % des routes nationales et 20 % des autoroutes nécessiteraient d’être rénovées selon le DIW).
Contre-ex. de l’Irlande et de la France (ajustement par les recettes) :
– En Irlande : transmission de la crise financière à la crise des finances publiques ( « Tigre celtique » : une croissance de 5 à 10 % a fait diminuer de moitié le ratio dette/PIB durant la décennie 1990) mais bulle immobilière et recapitalisation des banques => 32 % déficit en 2010. Dette publique de 25 % PIB en 2007 à 124 % en 2013 (multiplication par 5).
=> Consolidation budgétaire portée aux 2/3 par les PO, soit +1,2 point de PIB entre 2009 et 2014 (introduction d’une taxe foncière et d’une taxe sur l’eau par ex. : pression fiscale +1 000 € / foyer). Aussi effort en dépenses (réduction de la masse salariale de 17 %) et aide internationale pendant 3 ans (FESF et FMI = 67 Md€).
– En France, préférence collective pour la dépense publique (+6,5 points de PIB en dépenses publiques par rapport à la moyenne OCDE, en particulier sur les dépenses sociales (système de retraites = 3/4 de l’écart) et rigidité des dépenses dans leur composition selon France Stratégie, 2016). Peu d’efforts structurels sur la dépense publique (11 Md€ d’économies avec la RGPP entre 2007 et 2012 ; 29 Md€ avec le plan d’économies 2015-2017 mais toujours calculées par rapport au tendanciel : les dépenses ont continué à évoluer bien que plus lentement, ex. les dépenses pilotables de l’Etat devraient croître de 0,8 % en valeur en 2019 selon le PLF 2019) => dette publique proche de 100 % de PIB.
=> Ajustement brutal après 2008. Entre 2009 et 2015, les prélèvements obligatoires ont crû de 3,6 points de PIB pour réduire le déficit public, alors que les dépenses continuaient d’augmenter de 0,7 point de PIB => pèse sur les facteurs de production et réduit la croissance effective (inférieure à 1 % entre 2012 et 2015 : impact selon l’OFCE, 2017 de -0,4 pt en 2015 et -0,2 pt en 2016 et 2017).
Que se passe-t-il si l’on réduit le déficit en période de crise ?
1/ Paradoxe de Fisher (1933) : en période de crise, le désendettement public entraine chômage et croissance faible. Boucle dépressive : demande privée déprimée => déflation => récession => augmente la valeur réelle de la dette.
Ex. Royaume-Uni passe de 100 à 170 % de ratio dette/PIB entre 1918 et 1930 sous l’effet d’une politique de consolidation budgétaire et d’une politique monétaire restrictive visant à rétablir la parité or de la livre d’avant-guerre. Idem politique du « franc fort » sous Laval en 1935.
2/ De Grauwe (2013) : Depuis 2008, ce sont les pays de l’UE28 où la consolidation a été la plus forte qui ont connu la plus forte baisse de PIB et d’accroissement du ratio dette/PIB => inefficacité des consolidations si elles sont récessives (càd si réalisées par la hausse des PO ou la baisse de dépenses productives).
3/ Par contraste, les politiques de relance budgétaire redeviennent efficaces lorsque le multiplicateur keynésien est élevé et que l’équivalence néo-ricardienne ne joue pas (ex. New Deal : impulsion de +1,5 % PIB en 1934). DeLong & Summers, 2012 : multiplicateur budgétaire supérieur à 1 en moyenne OCDE (1,2 en France pour l’OFCE) et taux d’intérêt faibles = opportunité pour augmenter l’investissement public productif. Mais préférence pour les dépenses publiques non pérennes (ex. du GPI en France sur la formation ou la transition écologique).
Que prévoient les règles européennes ?
Aujourd’hui, la politique budgétaire au sein de l’UEM est soumise à des règles :
– Kydland & Prescott (1977) : au vu de l’incohérente temporelle des politiques budgétaires (une décision peut sembler optimale à court terme mais peu productive à moyen-long terme), il est préférable d’adopter des règles plutôt qu’une conduite discrétionnaire de la politique budgétaire.
– Pacte de stabilité (1997) puis TSCG (2012) : 3 % de déficit public, dont 0,5 % de déficit structurel, 60 % de dette publique et définition d’objectifs à moyen terme par pays, qui se traduisent dans les programmes de stabilité transmis chaque année en avril par les ministères des finances à la Commission européenne
– Examen également par des organes indépendants des hypothèses sous-jacentes aux projets de budgets pour assurer leur réalisme (cf. loi organique de décembre 2012 en France et création du Haut conseil des finances publiques)
Mais pour être efficaces, ces règles doivent être crédibles : or elles sont jusqu’ici inappliquées (ex. du conseil européen de 2005 où la France et l’Allemagne se sont coalisées pour éviter des sanctions pour déficit public excessif) et sans doute inapplicables (amende financière jusqu’à 0,5 % du PIB pour des pays déjà endettés ?) :
– Risque aujourd’hui autour du cas italien : 130 % de dette publique/PIB, un excédent primaire de 1,5 % du PIB en 2017 mais un déficit public prévu à 2,4 % selon le projet de budget pour 2019 (car la charge de la dette s’élève à 3,6 % du PIB), dont 0,7 point de PIB d’impulsion budgétaire par rapport à 2018 (0,3 point de baisse des PO et 0,4 point de hausse des dépenses publiques). Selon l’OFCE (2018), une remontée des taux obligataires à 10 ans au-delà de 5,6 % entraînerait une remontée du ratio dette/PIB et fragiliserait la soutenabilité de la dette publique italienne.
– CAE, 2018 : constat que le solde structurel est difficile à mesurer et le cadre budgétaire peu transparent, ce qui a reporté sur la BCE le rôle de stabilisation macro-économique durant la crise. L’existence de règles reste indispensable au sein de l’UEM, mais celles-ci doivent être crédibles, transparentes et simples pour assurer les fonctions de stabilisation macro-économique et de soutenabilité budgétaire. Le CAE propose ainsi de substituer aux règles du PSC/TSCG une règle unique pour concilier ces objectifs : les dépenses publiques ne devraient pas croître plus rapidement que le PIB potentiel.
Et la mondialisation dans tout ça ?
L’ouverture commerciale réduit les recettes fiscales par l’abaissement des droits de douane (Cagé, 2018 : impact négatif sur les pays en développement où ils représentent 1/4 des recettes fiscales, qui ne récupèrent pas de recettes à due concurrence sur les autres sources de fiscalité).
La politique budgétaire des Etats est également contrainte par la compétition fiscale :
– Réduction généralisée de l’impôt sur les sociétés (CEPII, « Impôt sur les sociétés : tous à 0 % ? », 2005). Ajd 25 % en moyenne UE contre 33 % en 1999 : réduction à 20 % au Royaume-Uni, 12,5 % en Irlande, 29,6 % en Allemagne mais stabilité norme fiscale, perspective 25 % en France en 2022 et réduction de 35 % à 15 % aux USA avec Trump. Facteur d’attractivité du territoire (mais pas le seul : infrastructures, formation, etc).
Elle est enfin réduite par l’optimisation (légale) et la fraude fiscales (entre 60 et 80 Md€/an de fraude en France mais difficile d’estimer finement) :
– au niveau national, réduction du nombre de niches fiscales et prélèvement à la source (Kleven, 2011 sur le système danois : pratiquement aucune évasion fiscale lorsque les revenus sont déclarés par un tiers et qu’il n’y a pas de niche fiscale)
– au niveau européen, accords fiscaux (ex. Pays-Bas / Starbucks) pour réduire l’assiette de calcul de l’impôt sur les bénéfices en cas de localisation du siège social : avantage indu selon la CE
– au niveau OCDE, échange d’informations, harmonisation des modalités de calcul de l’assiette (cf. directive ACCIS dans l’UE) et des taux (mais pas gagné : unanimité).